 Régulièrement, en association avec le magazine-web Histoire-Genealogie.com, je viendrai sur Geneablog vous relater un entretien avec une personnalité marquante de la généalogie, l'histoire, et la vie de nos ancêtres.
Régulièrement, en association avec le magazine-web Histoire-Genealogie.com, je viendrai sur Geneablog vous relater un entretien avec une personnalité marquante de la généalogie, l'histoire, et la vie de nos ancêtres.
Aujourd'hui, il s'agit de Alain Denizet, professeur d'histoire/géographie, qui vient de publier un livre sur son ancêtre Aubin Denizet « Au cœur de la Beauce, enquête sur un paysan sans histoire » :
1) Alain Denizet, pouvez-vous vous présenter ?
• Né à Dreux en 1959, je suis actuellement professeur d’histoire géographie à Bû après avoir exercé pendant 9 ans mon métier sous des latitudes écossaises et africaines, au Burkina Faso, puis au Niger.
• Etudiant en histoire à Tours à la fin des années 70, j’ai suivi les cours d’Alain Corbin dont l’enseignement fut déterminant, nous projetant en dehors des problématiques traditionnelles et rebattues. Des champs nouveaux étaient ouverts - le monde clos, la sexualité, les odeurs - chacun envisagé sous le mode de la réalité et de ses représentations. J’ai fait mon mémoire de maîtrise sous sa direction, analysant comment Zola dans les Rougon-Macquart envisageait l’intimité et la séduction.
2) Comment vous est venue l’idée d’écrire l’histoire de votre ancêtre, l’histoire de quelqu’un qui n’a laissé aucune trace, celle d’un inconnu de l’histoire ?
• J’avais entamé des recherches généalogiques, il y a plus de vingt ans, aiguisé par les conversations que j’avais avec mon grand-père, jamais avare de détails sur les temps passés. Là dessus, intervient une coupure avec les archives avec ces presque dix ans de carrière à l’étranger. De retour, je replonge dans les racines et repart à la quête des ancêtres avec, tout de même, une interrogation : des milliers d’ancêtres, oui ; mais au total que savais-je vraiment d’eux ?
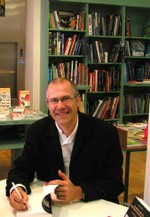 • En 1998, Alain Corbin publie son livre sur le sabotier Pinagot : c’est évidemment l’élément déclencheur. Une nouvelle fois, ce précurseur tente ce qu’aucun historien avant lui n’avait pensé ou osé : étudier un parfait inconnu, un sabotier analphabète de l’Orne. J’ai alors repris sa démarche pour écrire un livre sur le monde et la vie de l’arrière-grand-père de mon grand-père, Aubin Denizet.
• En 1998, Alain Corbin publie son livre sur le sabotier Pinagot : c’est évidemment l’élément déclencheur. Une nouvelle fois, ce précurseur tente ce qu’aucun historien avant lui n’avait pensé ou osé : étudier un parfait inconnu, un sabotier analphabète de l’Orne. J’ai alors repris sa démarche pour écrire un livre sur le monde et la vie de l’arrière-grand-père de mon grand-père, Aubin Denizet.
• Comme la majorité de nos aïeux, celui-ci n’a laissé aucune trace ; rien n’a traversé le temps, à l’exception de sa signature au bas de registres. C’était le premier ancêtre sur lequel les mémoires étaient muettes et qui, en dépit de la filiation qui me rattache à lui, m’était étranger. Mon grand-père ignorait son prénom et aucune histoire, petite ou grande, ne se raccordait à lui : ceci explique, avec mon intérêt personnel pour le XIXe siècle, le choix de lui donner chair et vie plutôt qu’à mes ascendants du XVIIIe et XVIIe siècle.
• Plus généralement, force est de constater que le genre biographique ignore les individus « ordinaires ». S’ils sont étudiés, c’est qu’ils ont laissé des récits de vie ou qu’ils nous sont connus par d’épais dossiers judiciaires ; de la sorte, ils se singularisent de nos ascendants par leurs parcours atypiques. Citons pour le XIXe siècle, Emile Guillaumin et « sa vie d’un simple », Jean-Marie Déguignet et ses « mémoires de paysan bas-breton » ou encore Pierre Rivière, le parricide étudié par Michel Foucault.
• Certes, paysans, ouvriers ou bourgeois ont été étudiés, mais collectivement, en tant que groupe social. Cette fois, si un individu s’extirpe de la masse, c’est pour affleurer à titre d’exemple le temps d’une page… pour disparaître la suivante.
• Décidemment, aucune de ces deux approches ne satisfait pleinement le généalogiste qui fait alors ce constat : nos ancêtres qui se comptent par millions sont ceux dont le parcours et le monde restent vagues alors que les livres s’accumulent, avec force détails, sur les figures connues de l’histoire.
• Ce questionnement m’a mené à enquêter sur Aubin Denizet et non, pour prévenir une question, sur son épouse. Centrer les recherches sur Marie-Louise aurait rendu la tâche périlleuse : si Aubin peut être cerné par sa visibilité sociale qui est liée à son statut d’homme, sa femme est presque ignorée des archives, reflet de sa situation de mineure juridique.
• Ainsi, la recherche a débuté avec les informations lapidaires de l’état civil : des noms, des prénoms, des dates et un métier.
3) Pouvez-vous expliquer votre démarche de travail ?
 • Première étape indispensable, j’ai listé les personnes qui constituaient l’entourage de mon ancêtre. C’était la garantie par la suite de sélectionner dans les archives les évènements qu’il avait eu le plus de chance de connaître à leur contact. D’abord sa parentèle et celle de son épouse, élargie jusqu’aux petits-cousins, puis ses voisins et connaissances du village que j’ai retrouvés par l’état-civil, les actes de notaires, le cadastre et les recensements. Chaque personne a fait l’objet d’une généalogie succincte.
• Première étape indispensable, j’ai listé les personnes qui constituaient l’entourage de mon ancêtre. C’était la garantie par la suite de sélectionner dans les archives les évènements qu’il avait eu le plus de chance de connaître à leur contact. D’abord sa parentèle et celle de son épouse, élargie jusqu’aux petits-cousins, puis ses voisins et connaissances du village que j’ai retrouvés par l’état-civil, les actes de notaires, le cadastre et les recensements. Chaque personne a fait l’objet d’une généalogie succincte.
• Puis, je me suis mis à la quête d’information aux archives départementales, diocésaines, communale, consultant aussi les archives privées du châtelain du village et la presse de l’époque à la bibliothèque municipale de Chartres. Chaque fonds a recelé des petits et grands trésors qui récompensèrent une fois trouvés les heures infécondes…
• Parmi toutes les sources utilisées, je dégagerai les archives de notaire, celles de la justice de paix et des assises (mines d’or pour la vie quotidienne) et, moins exploitées me semble-t-il, les archives communales qui, pour mon petit village de Germignonville, à l’exception des registres habituels, étaient conservées dans le grenier de la mairie.
• Or ces dernières sont généreuses dans la matière première qui intéresse le généalogiste : des noms, des prénoms, des dates, des listes ! La lecture des délibérations du conseil municipal donne ainsi, outre le nom des 12 conseillers, ceux des indigents aidés par la commune, ceux des artisans chargés de l’entretien des bâtiments publics, celui de l’instituteur et du garde-champêtre ainsi que leur rémunération. J’y ai découvert une liasse de 20 passeports intérieurs avec pour chacun le signalement physique de la personne concernée et le motif du déplacement, une autre liasse contenant le courrier échangé entre le maire et la préfecture au sujet de la sage-femme du village, trop empressée à mener les enfants « naturels » au tour de Chartres pour arrondir ses fins de mois.
• Toutes les personnes de l’entourage d’Aubin ont fait l’objet sur mon logiciel de généalogie d’une fiche individuelle qui a été complétée au fur et à mesure des renseignements recueillis. Ces mêmes informations ont été classées par thèmes dans des dossiers. Ainsi, les archives de notaire ont été rassemblées dans un premier dossier lui-même décliné en une série de fichiers correspondant chacun à une étude. Un second dossier a été fractionné en plusieurs fichiers selon le type d’acte (contrat de mariage, inventaire après décès…) afin de pouvoir établir des comparaisons, des statistiques et de recenser les occurrences d’un mot-clé grâce à la fonction « recherche » du traitement de texte. J’ai fait de même pour les autres séries.
 • Puis, j’ai trié et hiérarchisé les informations – chacune référencée - selon une règle d’or : mon ancêtre était la pièce centrale d’un puzzle dont les milliers de morceaux sélectionnés devaient éclairer sa vie et son monde. Parmi les pièces du puzzle, les 150 signatures d’Aubin qui attestent entre autres de sa participation au conseil municipal et donc des débats qui s’y sont déroulés, de ses visites chez le notaire et de son rôle de sergent-major dans la garde nationale ; d’autres pièces concernent ses proches : son fils Stanislas au séminaire, sa nièce qui abandonne son enfant au tour de Chartres, sa mère obligée de ravitailler les Prussiens pendant l’occupation de 1815, la faillite de son beau-frère ; d’autres enfin renseignent sur ses voisins : l’un bat sa femme, l’autre tient le cabaret, un autre encore est embarqué dans une affaire de faux en écriture qui l’amène à témoigner aux assises, sans oublier la sage-femme de 27 ans qui épouse un vieux barbon de 77 ans…
• Puis, j’ai trié et hiérarchisé les informations – chacune référencée - selon une règle d’or : mon ancêtre était la pièce centrale d’un puzzle dont les milliers de morceaux sélectionnés devaient éclairer sa vie et son monde. Parmi les pièces du puzzle, les 150 signatures d’Aubin qui attestent entre autres de sa participation au conseil municipal et donc des débats qui s’y sont déroulés, de ses visites chez le notaire et de son rôle de sergent-major dans la garde nationale ; d’autres pièces concernent ses proches : son fils Stanislas au séminaire, sa nièce qui abandonne son enfant au tour de Chartres, sa mère obligée de ravitailler les Prussiens pendant l’occupation de 1815, la faillite de son beau-frère ; d’autres enfin renseignent sur ses voisins : l’un bat sa femme, l’autre tient le cabaret, un autre encore est embarqué dans une affaire de faux en écriture qui l’amène à témoigner aux assises, sans oublier la sage-femme de 27 ans qui épouse un vieux barbon de 77 ans…
• En tout, 300 pages qui content la vie d’un simple dont on découvre au fil des pages l’histoire et le monde retrouvés.
4) Vous vous inspirez de deux démarches historiques bien différentes, celle de Jean-Claude Farcy, l’histoire quantitative, et celle d’Alain Corbin avec Pinagot…
• Les lectures préalables et en particulier la thèse monumentale de Jean-Claude Farcy sur les paysans beaucerons ont été indispensables en ce qu’elles m’ont permis de contextualiser le parcours d’Aubin ; le livre de Corbin m’a fourni la démarche et de judicieux conseils. Si je puis risquer une comparaison entre son livre et le mien, je dirai qu’il en diffère pour trois raisons : mon ancêtre étant plus aisé, il a offert plus de prises dans les archives communales et notariales que j’ai abondamment exploitées ; j’ai, me semble t-il, tenu plus compte des familiers, des voisins d’Aubin, postulant qu’il aurait connaissance de leurs affaires directement ou indirectement ; enfin mon ouvrage a une ambition moins réflexive.
 • Je crois qu’il est vain d’opposer l’histoire sérielle qui embrasse des groupes sociaux sur une longue période – un siècle pour les paysans de Farcy – et l’histoire qui s’intéresse à l’infime, au sans-grade. L’histoire gagne à être envisagée à toutes les échelles car elles se complètent.
• Je crois qu’il est vain d’opposer l’histoire sérielle qui embrasse des groupes sociaux sur une longue période – un siècle pour les paysans de Farcy – et l’histoire qui s’intéresse à l’infime, au sans-grade. L’histoire gagne à être envisagée à toutes les échelles car elles se complètent.
• Pour chacune d’entre elles, les généalogistes peuvent beaucoup apporter. L’étude massive des patronymes « TRA » qui a permis d’étudier leur mobilité géographique et sociale n’aurait pu se faire sans eux ; au niveau de l’individu, il va de soi qu’en exploitant toutes les sources disponibles, et non seulement les registres paroissiaux et les notaires, les généalogistes peuvent apporter un éclairage nouveau sur « les inconnus de l’histoire » et découvrir par chance une perle inédite dans des archives encore vierges de recherche : c’est ainsi que j’ai repéré dans un acte de notoriété la trace de Simon Lavo, seul membre de l’état-major de l’expédition Lapérouse dont on ne savait les origines géographique et sociale.
5) Combien de temps vous a-t-il fallu pour accomplir cette recherche et rédiger cet ouvrage ?
• A raison de deux journées par semaine, il m’a fallu cinq ans. Trois pour les recherches, deux pour l’écriture, mais aussi la mise en page et la couverture. J’ai voulu tout faire du début à la fin, en accord avec mon éditeur. Compte tenu des errements dus à l’inexpérience et aux difficultés à remettre « la machine à rédiger » en route, je crois que pour le même sujet, je gagnerai facilement un an.
6) Chaque généalogiste peut-il vraiment écrire l’histoire de l’un de ses ancêtres qui n’a pas laissé de traces ?
 • Multiplier les recherches sur nos « ancêtres sans histoire », c’est possible ! Mon ancêtre n’a pas une isibilité particulière dans les archives si l’on excepte sa fonction de conseiller. Il est par ailleurs moins présent que la moyenne dans les ventes mobilières, il est rare chez le notaire, n’apparaît pas dans les archives militaires ni dans les listes des indigents et une fois seulement dans celles qui, dans les inventaires après décès, désignent les débiteurs des artisans ou des commerçants et, décidemment « homme sans histoire », il n’a pas affaire au juge.
• Multiplier les recherches sur nos « ancêtres sans histoire », c’est possible ! Mon ancêtre n’a pas une isibilité particulière dans les archives si l’on excepte sa fonction de conseiller. Il est par ailleurs moins présent que la moyenne dans les ventes mobilières, il est rare chez le notaire, n’apparaît pas dans les archives militaires ni dans les listes des indigents et une fois seulement dans celles qui, dans les inventaires après décès, désignent les débiteurs des artisans ou des commerçants et, décidemment « homme sans histoire », il n’a pas affaire au juge.
• J’ai pu le constater : même un journalier peut apparaître sur les sources précitées. Je pense à Etienne Hamard qui est le crieur attitré des ventes mobilières : qui connaît mieux que lui les biens des familles, les acheteurs, leurs hésitations ou leurs emportements ?
• Chaque généalogiste peut donc entamer une recherche qui l’amènera à connaître mieux ses ancêtres à la condition qu’il se fixe un projet et un cadre précis. Nul n’est tenu d’écrire un livre pendant 5 ans ! Une enquête de base utilisera les actes de notaires et a minima les archives de la justice de paix, une enquête plus poussée exploitera les archives municipales et militaires ; le généalogiste-historien ambitieux et disposant de temps ajoutera toutes les autres !
• Les résultats de l’enquête peuvent être simplement communiqués à la famille sous la forme d’un journal ou d’un blog ou encore faire l’objet d’une communication dans le journal d’un cercle de généalogie ou d’un article dans une revue d’histoire locale. Enfin, il y a la solution d’un livre à compte d’auteur ou chez un éditeur régional. Ce fut mon cas.
• Et les recherches pour rendre visite à nos aïeuls du XVIIIe siècle ? Je n’ai que très peu travaillé sur ces années et l’avis d’un spécialiste serait donc le bienvenu, mais à priori l’enquête m’apparaît plus délicate. Les sources sont moins abondantes : point de recensements réguliers, ni de cadastres, ni d’enquêtes agricoles village par village si précieuses, ni de délibérations du conseil dans les petites communes où il faut se contenter des assemblées de paroisses, ni de listes d’électeurs… et j’en passe. Mais le maillage des notaires ou des tabellions est plus dense et il y a la série B, très riche en fait divers de toutes sortes. Surtout et paradoxalement, les livres sur les inconnus de l’histoire sont plus nombreux que pour le XIXe siècle et donnent de précieux conseils de méthode et des pistes de sources. Dans l’ordre, citons le livre de Jean Vassort sur Pierre Bordier, laboureur et marchand du Vendômois, celui d’Anne Fillon sur l’étaminier Louis Simon, celui de Jean-Marie Goulemot sur l’enfance et l’éducation de Valentin Jamerey-Duval.
7) Avez-vous un nouveau projet d’écriture ?
 • L’ « enquête sur un paysan sans histoire » est mon premier livre. Les critiques des lecteurs, celles des revues et des sites de généalogie m’encouragent à en écrire un second. Cette fois, je ne partirai pas avec un dossier vide puisque j’entends m’intéresser à une criminelle, à une femme rurale du XIXe. L’objectif sera autant de raconter son crime (ce peut être, en début de siècle, le vol de gerbe de blé la nuit…) que de saisir sa vie et son monde.
• L’ « enquête sur un paysan sans histoire » est mon premier livre. Les critiques des lecteurs, celles des revues et des sites de généalogie m’encouragent à en écrire un second. Cette fois, je ne partirai pas avec un dossier vide puisque j’entends m’intéresser à une criminelle, à une femme rurale du XIXe. L’objectif sera autant de raconter son crime (ce peut être, en début de siècle, le vol de gerbe de blé la nuit…) que de saisir sa vie et son monde.
• Alors, rendez-vous dans trois ou quatre ans ! Avec d’ici là, je l’espère, d’autres livres de passionnés de généalogie qui nous auront fait partager la vie de leurs « ancêtres sans histoire ».
Pour en savoir plus :
§ Histoire-Genealogie : Présentation de l'ouvrage d'Alain Denizet.
§ Bibliogen : « Au coeur de la Beauce, enquête sur un paysan sans histoire »
§ Éditions Centrelivres : 14 rue Marceau - 28600 Luisant - Tél 02.37.30.19.43.
§ Histoire-Généalogie : Quelles sont les sources utilisées pour écrire la vie d'un inconnu de l'histoire ?
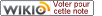
je tiens à féliciter Alain Denizet pour son livre.
Je suis actuellement en train de le lire et je me régale.
Depuis deux ans je collecte les renseignements sur ma famille et j'envisage aussi d'écrire un livre .
Il n'aura certes pas la classe de celui ci car je ne suis pas historien ,mais seulement commerçant .
j'espère trouver aussi un éditeur.
bravo encore.
Rédigé par : pierre chuto | 28 septembre 2007 à 22:13
Bonjour Pierre,
En ce qui concerne l'éditeur, il y a la solution Lulu. Voir la note de France Apprill sur le sujet :
http://geneablog.typepad.fr/geneablog/2007/05/lulucom_vous_pu.html
Serge.
Rédigé par : Serge Busiau | 29 septembre 2007 à 00:57
Je viens de lire ce livre avec beaucoup d'intérêt. Ancien résident de Chartres, retraité de la sphère comptable et administrative, je vis maintenant en 17. J'ai apprécié de cheminer dans ce passé où la vie, les relations et la famille d'Aubin ont généré les images que j'ai pu imprimer. Grâce à l'auteur bien sûr et avec l'avantage de connaître la région. Un régal pour un retraité comme moi. Bravo.
Mars 2012
Rédigé par : Michel LEMOINE | 20 mars 2012 à 15:53